Namaste, entre réappropriation culturelle et clichés New Age
Rédigé en octobre 2022
Introduction :
Le terme "Namasté" est d'origine hindoue et représente une manière courante de saluer et honorer respectueusement autrui. Utilisé principalement sur le sous-continent indien ainsi que parmi les diasporas népalaise et indienne, le mot provient du sanskrit, combinant "namah" qui signifie « inclination, obéissance, adoration » et le pronom enclitique "te", signifiant « vers toi ». Bien qu'il trouve sa place dans la littérature védique, son utilisation a aujourd'hui dépassé sa culture d’origine, se répandant parmi de nombreux occidentaux, notamment dans les milieux New Age et les nouvelles spiritualités.
Peut-on parler d’appropriation culturelle ? Cela semble envisageable, car l’usage du Namasté est parfois peu justifié et devient alors abusif. Il est souvent perçu comme un simple accessoire, utilisé pour afficher une image spirituelle, sage ou érudite. Ces milieux, souvent stéréotypés, présentent des codes vestimentaires et esthétiques spécifiques, ainsi qu’un vocabulaire distinctif. Les adeptes se différencient par leur manière de s’exprimer, les vêtements qu’ils portent, leurs bijoux symboliques, la décoration de leurs intérieurs et leurs lectures. Cependant, ce besoin d’affirmer une identité particulière peut, si l'on n’y prend pas garde, se transformer en une manifestation de ce qu’on appel l'égo spirituel. C’est à dire une idée que l’on se fait de soi-même erronée, comme étant une personne plus spirituelle que les autres, une sorte de personnage ou de masque qu’on s’invente inconsciement.

Stéréotypes et clichés des milieux dits « spirituels »
En observant le milieu New Age et des nouvelles spiritualités contemporaines (coachs spirituels, développement personnel, praticiens holistiques, et autres désignations), on se rend vite compte qu'il est visuellement très stéréotypé, parfois jusqu'à friser la caricature. On y retrouve des postures en tailleur, les mains jointes, des poses en pleine nature avec les yeux fermés devant un lac, une cascade ou un jardin. Les adeptes portent souvent des vêtements amples, entourés d'encens, de bougies, et évoluent dans des décors avec des cabanes en bois, des yourtes ou des tentes. Les femmes affichent généralement des cheveux longs, et certains hommes arborent également des barbes. Les images de galets empilés, de fleurs de lotus, de statues de Bouddha ou d'autres divinités, ainsi que des attrape-rêves, sont omniprésentes.
La communication visuelle de ce milieu est devenue si clichée et stéréotypée qu'il suffit presque d'adopter ces codes graphiques et vestimentaires pour se faire passer pour un nouveau thérapeute, guide, coach ou sage aux yeux du grand public. Mais comme le dit le proverbe : « L’habit ne fait pas le moine », et le Namasté ne transforme pas forcément quelqu'un en sage ou en guide spirituel.
Pour une illustration humoristique de ce phénomène, je vous recommande le film PROBLEMOS, qui caricature ce milieu avec un casting comprenant Éric Judor et Blanche Gardin, ainsi que la série de cette dernière sur Canal+, LA MEILLEURE VERSION DE SOI-MÊME.
Pourquoi peut-on parler de snobisme spirituel ?
Selon le Larousse, le snobisme se définit comme « une admiration inconditionnelle pour les manières et les opinions en vogue dans les milieux considérés comme distingués, se manifestant par une imitation servile de leur comportement. »Le snobisme spirituel se traduit par l'imitation de comportements issus de milieux ou de personnes spirituelles que l’on perçoit comme plus raffinés connaissant, expérimentés, éveillés spirituellement parlant ou supérieurs. Par exemple, un participant à un stage spirituel pourrait adopter le « Namasté » de l'animateur qu'il considère comme une référence, sans remettre en question ou s’interroger la légitimité de cet usage.
Utiliser le bon terme à bon escient, dans le bon contexte
Le terme "Namasté" est une translittération du sanskrit, souvent traduit en français par l’expression : « Je salue (j’honore) le divin qui est en toi ». Dans certaines régions de l’Inde, il peut également être employé simplement pour dire « bonjour » ou saluer respectueusement. Ce mot fait partie intégrante de la culture hindoue. Le geste qui l’accompagne est également utilisé pour rendre hommage à une divinité, par exemple en passant près d’un temple ou d’un tombeau.
En Occident, il est souvent employé par les enseignants de yoga dans le cadre de leurs cours, ce qui me semble logique, car le yoga est ancré dans cette culture. C’est comparable à l’utilisation de termes japonais dans les cours de judo, ce qui me paraît tout à fait approprié dans ce contexte. En revanche, en dehors de ces milieux, cela soulève des questions. Je n’ai jamais observé de professeurs de judo de ma région saluant leurs élèves et leurs parents en japonais en dehors du dojo. Pourtant, de nombreux adeptes des philosophies ou spiritualités New Age utilisent le Namasté en dehors de leur sphère de pratique, avec des personnes qui ne partagent pas leurs croyances ou qui ne sont pas membres de leurs groupes, ateliers ou cercles.
Utiliser "Namasté" hors du contexte culturel hindou : est-ce respectueux ?
Cette situation soulève des questions, notamment lorsqu'on affirme que le Namasté est une marque de respect. En quoi est-il respectueux de saluer quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas ? Par exemple, si un Letton me salue dans sa langue, même s'il y met toute l'attention et le respect possibles, le mot et son intention demeureront incompris pour moi. Cela semble être une question de bon sens, non ?
L'usage du Namasté en dehors du cadre du yoga ou d'une activité liée à la culture hindoue devient d'autant plus absurde lorsque les deux interlocuteurs parlent la même langue. Par exemple, dans l'intimité (au lit, par exemple), diriez-vous « Je t’aime » à votre partenaire en sanskrit, une langue qu'il ne maîtrise pas ? Feriez-vous de même avec vos jeunes enfants ou un parent âgé qui ne comprend pas ce terme et ne pratique pas le yoga ? Probablement pas. Il me semble que lorsque nous souhaitons saluer quelqu'un et lui exprimer notre respect sincère, la manière la plus appropriée et simple est de le faire avec des mots de sa langue et selon les conventions de sa culture.
Lorsque l’on respecte quelqu’un, on s’efforce d’être accessible, de se mettre à son niveau. Utiliser un mot inconnu et ensuite devoir expliquer son sens revient à chercher à étaler ses connaissances, à montrer sa « spiritualité » en employant un terme tendance dans ce milieu. C'est donc en total décalage avec l'esprit et la signification du Namasté.
Sincérité rime avec simplicité !
Pour faire preuve de sincérité et de respect envers quelqu'un, adoptez une approche simple. Mettez-vous à son niveau et évitez de l'embrouiller avec un vocabulaire ou des concepts qui lui sont étrangers, issus d'une autre culture. Il n'est pas nécessaire de recourir à une langue ancienne simplement pour afficher votre identité ou votre appartenance à un courant spirituel. Chercher à paraître comme « quelqu'un de particulier » relève davantage d'un désir de l’égo spirituel.
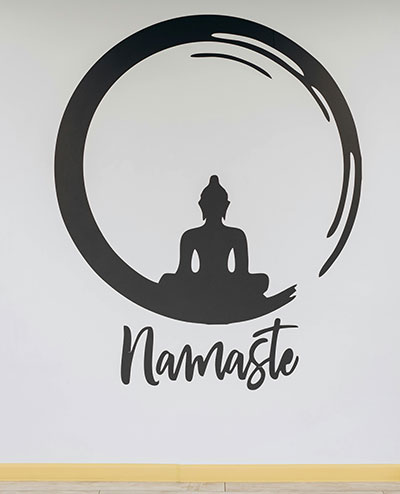
Natacha Aubriot, octobre 2022